LES SERVICES DE LA FORÊT: TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ (rapport INRA Chapître3/4)
Publié le 7 Juillet 2018
L’effet « Mac Donald » guette la forêt
De Lisbonne à Pékin, d’Abidjan à Lima, dans les rues marchandes et les centres commerciaux, vous trouvez les mêmes restaurants, les mêmes marques de prêt-à-porter, chaussures, cigarettes ou appareils électroniques. Pour les paysages, c’est un peu la même chose : ceux-ci connaissent une homogénéisation croissante au profit d’un nombre limité d’espèces végétales ou animales. C’est ce que les experts ont appelé l’effet « Mac‑Donald ».
Ainsi, dans le monde, les forêts naturelles perdent du terrain tandis que l’introduction et l’expansion d’un nombre limité d’espèces d’arbres contribue à cette uniformisation. Près de la moitié des forêts françaises sont des peuplements dominés par une seule espèce d’arbre. Or, dans un paysage ne contenant que très peu d’espèces végétales, on trouve une variété moindre d’oiseaux, mammifères, insectes ou champignons.
Les bénéfices, ou services écosystémiques, que l’homme retire du fonctionnement d’un peuplement constitué d’une seule essence sont ainsi moins nombreux.
De plus, dans certains cas, la vulnérabilité de ces peuplements face aux menaces peut augmenter. Mais l’écologie est une science de la complexité : les conclusions hâtives peuvent mener à de graves erreurs. Voilà pourquoi les chercheurs de l’Inra mesurent la biodiversité des forêts françaises et évaluent leur capacité à fournir différents services écosystémiques.
L’Europe des services forestiers
Quel est l’impact de l’effet « Mac Donald » sur la capacité des forêts à offrir des services écosystémiques ? C’est la question posée dans le cadre d’un vaste projet de recherche, appelé FunDivEUROPE, associant 29 équipes européennes dont certaines de l’Inra. Les chercheurs ont combiné des données provenant de six pays, puis ils ont développé des simulations informatiques pour tester les conséquences de l’homogénéisation biotique et du déclin de la diversité des arbres sur la capacité des écosystèmes forestiers à assurer seize fonctions essentielles telles que la production de bois d’œuvre, le stockage de carbone, la résistance aux bioagresseurs ou le maintien de la diversité des oiseaux.
Le résultat est sans appel : dans presque tous les cas, l’uniformisation diminue la capacité des forêts à fournir des services multiples. Ce résultat plaide pour une revalorisation des paysages riches en espèces différentes, à même de remplir le plus grand nombre de fonctions environnementales, économiques ou sociales

La Queue fourchue du hêtre (Furcula furcula) est une chenille qui se nourrit sur le hêtre, les saules, les bouleaux et les chênes. Lorsqu’elle est dérangée, elle prend une posture défensive en projetant vers l’avant les deux expansions de sa « queue fourchue ».
Les agresseurs en danger dans les forêts mélangées
Les recherches le montrent bien : une plus grande diversité d’arbres favorise la résistance de la forêt face aux agresseurs. Prenons par exemple un ravageur bien connu, le scolyte. Pour survivre, il doit trouver son arbre hôte. Pour cela, il s’aide de l’odeur de l’arbre et de sa silhouette, ou encore, des phéromones attractives de ses congénères. Dans une forêt monospécifique de pins, le scolyte est sauvé : tous les arbres lui conviennent.
Mais dans une forêt mélangée, l’affaire se corse. Les pins sont en quantité moindre et les autres arbres constituent des barrières visuelles et odorantes.
De plus, la diversité des plantes tend à favoriser la diversité des ennemis des agresseurs, qu’il s’agisse d’oiseaux prédateurs ou d’insectes parasitoïdes. Dans ces conditions, il est moins probable qu’un insecte voie sa population exploser et mettre en danger la croissance et la survie des arbres.
Cependant, il peut y avoir des exceptions : d’une part, il existe des insectes herbivores, tels que le bombyx disparate, dont la chenille peut se nourrir de plusieurs espèces d’arbres feuillus, voire de conifères. D’autre part, dans certains cas, les prédateurs peuvent aussi se dévorer entre eux et diminuer leur capacité à contrôler un agresseur des forêts.
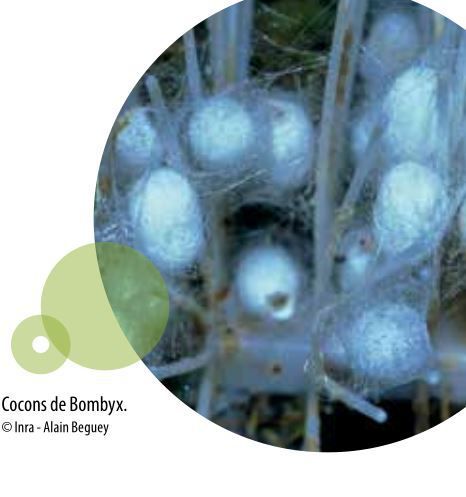
L’incroyable biodiversité de l’enfer vert
Prendre la mesure de la biodiversité des arbres d’Amazonie : voilà la tâche herculéenne que s’est donnée une équipe internationale à laquelle participe l’Inra. Les chercheurs ont dressé le premier inventaire à large échelle des arbres du bassin amazonien.
Pour comprendre l’ampleur de la tâche, quelques chiffres suffisent : l’Amazonie s’étend sur près de 6 millions de km 2 et sur 9 pays. Cette forêt humide compte 390 milliards d’arbres appartenant à environ 16 000 espèces. On y trouve entre 210 et 300 espèces différentes par hectare.
Au cours de leurs travaux, les chercheurs sont parvenus à une conclusion étonnante : la moitié des arbres amazoniens appartiennent à seulement 227 espèces. Ils voudraient à présent comprendre les causes de cette hyperdominance.
Par ailleurs, ils ont recensé 11 000 espèces rares qui ne représentent en tout que 0,12 % des individus. Celles-ci sont menacées par la déforestation et risquent de disparaître avant même d’avoir été décrites convenablement.
Honneur aux petites forêts fragmentées Les petites forêts, bois et bosquets sont très fréquents dans beaucoup de paysages en France. Leurs caractéristiques leur confèrent des rôles environnementaux, mais aussi économiques et culturels qui méritent d’être mieux connus, reconnus et valorisés.
Ces petites forêts sont bien souvent le principal réservoir de biodiversité dans les paysages agricoles. Les espèces qu’elles abritent sont en général relativement communes, mais bon nombre d’entre elles rendent des services écosystémiques aux agriculteurs et à d’autres bénéficiaires, par exemple en abritant des pollinisateurs et en régulant les populations d’espèces considérées comme nuisibles aux activités humaines.
Leur dispersion sur le territoire est en outre un atout pour une production de biomasse (bois énergie notamment) au plus près des utilisateurs. Les recherches visent aujourd’hui à mieux tirer profit de leurs spécificités dans la perspective d’une agroécologie des paysages.
Les services rendus par la forêt : source ou puits de carbone (rapport INRA chap 1/4)
Les services de la forêt Le pouvoir des sols (rapport INRA chap 2/ 4)
Les services de la forêt : trésor de biodiversité (INRA chap3/4)
Les autres services de la forêt : bois, chasse, récréation (INRA chap 4/4)
Les risques pour la forêt La forêt agressée (INRA chap 1/3)
Les risques pour la forêt: l’arbre face à la sécheresse (INRA chap 2/3)
Les risques pour la forêt: tempêtes et feux (INRA chap 3/3)
Quelles forêts pour le futur ? la sylviculture de demain (INRA chap 1/4)
Quelles forêts pour le futur ? : S’adapter à la rareté des ressources en eau (INRA chap 2/4)
Quelles forêts pour le futur ? Des ressources génétiques pour les forêts (INRA chap 3/4
Quelles forêts pour le futur ? Adapter la sylviculture : serait-il urgent d’attendre ? (INRA 4/4)

/image%2F1479375%2F20220420%2Fob_7fe25c_4246660298920266123.jpg)
/image%2F1479375%2F20230203%2Fob_053edc_anab-banner-beber-01.jpg)
